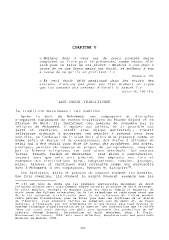Page 101 - LJC Francais
P. 101
CHAPITRE V
« Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains
composent un livre puis le présentent comme venant d’A-
llah pour en tirer un vil profit ! Malheur à eux donc à
cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux
à cause de ce qu’ils en profitent ! »
(Coran 2, 79)
« Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des
anciens, n’est-ce pas pour eux [les Arabes] un signe
que les savants des enfants d’Israël le savent ? »
(Coran 26, 196-197)
LES DEUX TRADITIONS
La tradition musulmane : les hadiths
Après la mort de Mohammed, ses compagnons et disciples
s’emparent rapidement de vastes territoires au Proche-Orient et en
Afrique du Nord. Ils justifient ces guerres de conquête par la
religion de Mohammed. L’imposer aux païens, et si possible aux
juifs et chrétiens, serait leur unique motivation ; l’unité
religieuse aiderait à gouverner ces peuples à présent sous leur
contrôle. Le fondateur de l’islam doit alors être présenté comme un
homme pétri de morale et de connaissance, des vertus à attendre de
celui qui a été choisi pour être le sceau des prophètes. Des actes,
prodiges, paroles de sagesse et propos de jurisprudence, imaginés
par la ferveur religieuse, lui sont alors attribués. Les sources
juives –Tanakh, Talmud et Midrachim – sont mises à contribution,
souvent sans que cela soit précisé. Des emprunts aux lois et
coutumes des civilisations juive, babylonienne, romaine, grecque,
perse, hindoue et chrétienne sont présentés comme des nouveautés
dues à Mohammed, à ses compagnons, épouses et disciples .
390
Ces histoires, faits et paroles de sagesse forment les hadiths.
Une fois compilés, ils donnent la sainte Sounnah –exemple que les
390 « Il est hors de doute que les premiers spécialistes musulmans en droit
religieux doivent avoir consciemment adopté certains principes de droit étranger.
De cette manière, concepts et maximes issus des droits romain et byzantin, du
droit canon des Églises orientales, de la loi talmudique et rabbinique ainsi que
de la loi sassanide s’infiltrèrent dans la loi religieuse de l’islam pendant
e
cette période d’incubation, pour se faire jour dans les doctrines du II siècle
de l’hégire ». « Les premiers califes ne nommèrent pas de qâdis et, de façon
générale, n’établirent pas les fondements de ce qui devait plus tard devenir le
système islamique d’administration de la justice. Les instructions que le calife
e
‘Umar est censé avoir données aux qâdis sont également des productions du III
siècle », Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, chap. 4, Paris,
Maisonneuve et Larose, 1999. Voir aussi Goldziher, Neuplatonische und gnostische
Elemente im Hadith, 1909.
101